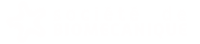Joris Léonet soutiendra sa thèse à l'IRPHE (Marseille) le 3 novembre 2025 à 14h.
Titre : Caractérisation et Modélisation de Milieux Biologiques Poreux – Application au Thrombus Intraluminal d’Anévrisme de l’Aorte Abdominale
Encadrement : Valérie Deplano, Jérôme Vicente.
Résumé : Un anévrisme de l’aorte abdominale (AAA) est une pathologie de la paroi aortique, caractérisée par une dilatation localisée et anormale de l’aorte, la plus grande artère du corps humain. En l’absence de prise en charge clinique, elle évolue généralement vers une rupture de la paroi anévrismale, entraînant une hémorragie interne souvent fatale. Malgré les avancées dans la compréhension de cette pathologie, les mécanismes exacts conduisant à la rupture d’un AAA ne sont pas encore totalement élucidés. Parmi les facteurs potentiels, le thrombus intraluminal (TIL), présent dans la majorité des cas d’AAA, est suspecté de jouer un rôle central. Le TIL est un agrégat d’éléments cellulaires (globules rouges, plaquettes, etc.) incorporés dans un réseau tridimensionnel de fibrine, se développant au sein du sac anévrismal. Dans la littérature, les études expérimentales portant sur la microstructure du TIL sont encore limitées, se concentrant principalement sur des observations en deux dimensions et sur des modélisations mécaniques restreintes à des comportements élastique, hyperélastique et parfois poroélastique. Ces travaux ont montré que le TIL est un milieu hétérogène complexe, multicouches et poreux, présentant des gradients de perméabilité susceptibles de contribuer à l’hypoxie locale de la paroi anévrismale, et donc à sa rupture. Toutefois, une caractérisation morphologique et mécanique plus fine semble essentielle à la validation de cette hypothèse. Cette thèse vise à caractériser la microstructure et les propriétés mécaniques du TIL en vue de développer un modèle exploitable dans des simulations numériques, permettant d’éclairer son rôle dans l’évolution de la pathologie. Sa microstructure tridimensionnelle a été analysée par microtomographie aux rayons X, permettant d’extraire des paramètres essentiels tels que la porosité, le diamètre des pores, l’anisotropie et la connectivité. La perméabilité a ensuite été estimée par modélisation en réseau de pores, révélant que seule la couche luminale, en contact direct avec le flux sanguin, est significativement perméable. Ces résultats ont été confirmés par analyses histologiques et essais macroscopiques. Le lien entre organisation morphologique et propriétés mécaniques a été étudié au moyen d’essais de compression in-situ réalisés sous rayonnement synchrotron à contraste de phase, approche inédite pour ce tissu. Cette méthode a permis de visualiser des détails non accessibles par microtomographie classique, tels que de petits pores et les fibres de fibrine. Les résultats ont mis en évidence un comportement viscoélastique non linéaire accompagné de remaniements structuraux : diminution de la porosité, réduction du diamètre des pores et perte de connectivité. Selon l’architecture initiale, la réorganisation des fibres de fibrine varie d’ordonnée à fortement désorganisée. Enfin, la réponse mécanique du TIL a été modélisée à l’aide d’un modèle viscoélastique simple. Bien que préliminaire et ne tenant pas compte de la porosité, ce modèle concorde avec plusieurs observations expérimentales. La couche abluminale présente une rigidité et une capacité de stockage d’énergie plus élevées, associées à une moindre dissipation. La couche luminale domine à faibles déformations, tandis que les couches plus denses interviennent à fortes déformations, augmentant rigidité et contrainte maximale. Ce modèle décrit le comportement global du TIL mais devra intégrer ultérieurement une composante poreuse pour refléter plus fidèlement la réalité. Ces résultats constituent une base solide pour la modélisation numérique du rôle du TIL dans la progression de l’AAA.