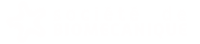Actuellement Professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille et membre de l’Institut des Sciences du Mouvement (UMR CNRS-Aix Marseille Université), ma thèse a concerné l’étude de corps viscoélastiques soumis à de grandes variations de température. Durant mon post-doctorat à l’ONERA, sous la direction de Jean-Louis Chaboche, j’ai travaillé sur la modélisation de la fissuration en fatigue oligocyclique dans le cadre de la prévision de la durée de vie des composants à haute température.
Recruté comme chargé de recherche au CNRS, mes travaux au Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique ont porté sur la caractérisation mécanique de comportements complexes ainsi que sur la mécanique du contact et du frottement. J’ai développé des modèles et des méthodes pour l’analyse des effets de surface, pour l’étude du contact, du frottement et de l’usure en grandes déformations et grands déplacements. Lors d’un détachement à l’Université de Birmingham, j’ai travaillé sur la modélisation du frottement dans la simulation numérique des procédés de mise en forme.
À partir de 1995, j’ai progressivement réorienté mes recherches vers la biomécanique, avec l’idée initiale d’appliquer le savoir-faire acquis en tribologie à l’étude de l’usure des prothèses ostéoarticulaires. En 2002, j’ai choisi un poste de professeur, plutôt que celui de directeur de recherche pour me consacrer pleinement à la biomécanique et développer l’offre de formation au sein de la Faculté des Sciences du Sport de l’Université d’Aix-Marseille. J’ai été vice-doyen recherche, responsable du master « Sciences du Mouvement Humain » (cohabilité avec les universités de Nice, Toulon, Avignon et Montpellier) et en 2012, j’ai créé le parcours de M2 « Bioingénierie des Implants et des Tissus », en partenariat avec plusieurs UFR d’AMU, l’École Centrale de Marseille et l’École des Mines d’Alès.
Mes recherches ont porté sur la biomécanique des matériaux et des structures, en combinant approches théoriques, expérimentales et numériques. L’objectif principal était d’étudier le système ostéoarticulaire à différentes échelles (cellulaire, tissulaire et organe). Je me suis intéressé à la caractérisation des matériaux biologiques, à la modélisation des interactions matériaux biologiques/matériaux de l’ingénieur pour intégrer la qualité du matériau osseux dans la conception, la fabrication et l’implantation des dispositifs médicaux implantables.
J’ai codirigé deux GDR CNRS (Biomécanique des chocs et Mécanotransduction), participé à l’organisation d’une trentaine de congrès et symposiums, et présidé en 2013 le comité d’organisation du congrès de la Société de Biomécanique à Marseille. J’ai également été président de MECAMAT (Groupe français de Mécanique des Matériaux), membre élu du Conseil d’Administration du CSMA, et membre du Conseil d’Administration et du Conseil Scientifique de l’AFM. Avec Thierry Hoc, j’ai organisé en 2012 l’école thématique CNRS « Biomécanique et bioingénierie du vieillissement des tissus », à Marrakech.
J’ai contribué à la création du corps de chercheur du ministère de l’écologie et à celle de sa commission d’évaluation (COMEVAL) dont j’ai été nommé président. Je préside le Comité CESAR qui évalue les ingénieurs assurant des fonctions de chercheur dans les établissements qui ont pour tutelle le ministère de l’écologie.
Laboratoire / Entreprise / Ville / Pays
Institut des Sciences du Mouvement UMR 7287, Aix-Marseille Université et CNRS, Marseille.
Par quel biais avez-vous été amenée à vous intéresser à la biomécanique ? Quelle a été votre première expérience en lien avec la biomécanique ?
Deux rencontres ont accompagné la réorientation de mes recherches dans le domaine de la biomécanique.
La première s’est faite à Marseille, au Laboratoire de Biomécanique Appliquée, dirigé alors par un chirurgien, Jean Bonnoit, assisté d’un ingénieur, Claude Cavalero. Bien qu’ils aient été initialement sceptiques quant à l’apport de la modélisation, nous avons lancé ensemble une thèse sur la modélisation mécanique et numérique des ligaments du genou, menée par Pierre-Jean Arnoux. Ces travaux ont ouvert la voie à l’étude du comportement dynamique des tissus biologiques, notamment à travers les thèses de Martine Pithioux et de Damien Subit. La création par le CNRS et l’INRETS (devenu IFSTTAR et Université Gustave Eiffel ensuite) d’un GDR a permis de structurer une communauté scientifique active, favorisant collaborations et relations amicales.
La seconde rencontre a eu lieu avec Alain Meunier, du LB2OA (Faculté de médecine de Lariboisière, laboratoire dirigé à l’époque par le Professeur Laurent Sedel) à Paris. Nos échanges sur la tribologie des implants articulaires ont abouti à la création du groupe de travail « Tribologie des prothèses » au sein du club Crin Tribologie. J’ai par la suite représenté la France au management comitee du COST Biotribology : Materials for Improved Wear Resistance of Total Artificial Joints. Mes discussions avec Alain et Laurent m’ont convaincu de l’importance des rapprochements entre chercheurs et cliniciens. J’ai décidé alors d’orienter mes recherches vers l’étude du système ostéoarticulaire, qu’il soit sain, pathologique ou prothésé.
Auriez-vous une définition de la biomécanique ?
On définit souvent la biomécanique comme l’application de la mécanique au vivant, une formule utilisée en 1980 par Paul Germain, secrétaire perpétuel de l’académie des sciences. Cette définition trop réductrice néglige l’indispensable dimension pluridisciplinaire.
Pour ma part, je préfère définir la biomécanique comme la science qui étudie la mécanique et les mécanismes du vivant. Cette approche permet d’intégrer non seulement les concepts de la mécanique, mais aussi ceux de la biologie, des sciences médicales et de bien autres disciplines.
Quels sont les éléments que la biomécanique pourrait vous apporter dans vos recherches à plus ou moins long terme?
Mes recherches se situant déjà au cœur même de la biomécanique, il m’est difficile d’identifier un apport spécifique « extérieur ». La biomécanique n’est pas un outil complémentaire, mais bien le socle sur lequel reposent l’ensemble de mes travaux.
Quelle est selon vous la découverte marquante des 30 dernières années de la biomécanique qui vous a le plus apporté ?
Je dirais que ce sont les progrès dans la conception de modèles permettant de caractériser le comportement du corps humain ou de ses segments anatomiques. Ces avancées ont été rendues possibles grâce à l’appropriation par les biomécaniciens de l’imagerie médicale, devenue de plus en plus précise, ainsi qu’à l’utilisation de techniques d’analyses histologiques, morphométriques et biochimiques.
Ces outils, associés aux outils classiques des mécaniciens, ont permis la personnalisation des modèles et le développement de lois de comportement, souvent basées sur des approches multi-échelles allant de la cellule, au tissu et à l’organe. La modélisation 3D à partir d’images médicales a nécessité la mise au point de logiciels de traitement et de segmentation d’images. Aujourd’hui, ces modèles, de plus en plus complexes, aident non seulement à mieux comprendre la réponse du corps humain à différentes sollicitations, y compris en dynamique. Ils aident également à la planification préopératoire et à assister le chirurgien dans son geste opératoire.
Dans votre domaine quelles sont les apports et les développements à attendre dans les prochaines années ?
Je distinguerais deux axes : la recherche amont et la recherche finalisée.
En recherche amont, les modèles mécanobiologiques multi-échelles vont gagner en précision. Ils devraient devenir des outils essentiels pour prévoir l’évolution des tissus biologiques et pour développer des « jumeaux numériques » fiables, capables par exemple de simuler la stabilité, l’efficacité et la durée de vie d’un implant. Les modèles de remodelage osseux commencent à intégrer, non seulement les pathologies mais aussi les thérapies et les effets secondaires de différents autres traitements – par exemple les effets de la chimiothérapie ou de la radiothérapie sur la qualité osseuse. L’aspect prédictif, sur le moyen ou long terme, est particulièrement prometteur : il permettra d’apporter des informations complémentaires à celles observées à un instant donné.
Dans le cas des tissus osseux, ces modèles associés à des modèles de rupture permettront une évaluation fine du risque fracturaire et pourront servir de support pour l’adaptation ou la mise au point de nouvelles stratégies thérapeutiques.
L’impression 3D ouvre la voie à la fabrication de structures complexes en matériaux biodégradables fonctionnalisés, mimant au mieux la mécanique et la biochimie des tissus natifs. La maîtrise de leur colonisation cellulaire et des processus de mécano-transduction pourrait permettre de créer de nouveaux types d’implants (par exemple de cartilage ou de ménisque) et répondre ainsi à des besoins cliniques importants, notamment lors de reconstructions après résection de grands volumes osseux.
En recherche finalisée, la planification préopératoire apparaît centrale. L’imagerie 3D nécessite la mise au point de techniques de détermination automatique de référentiels ouvrant la voie à la conception d’implants ou d’instrumentations patients spécifiques.
L’utilisation de modèles individuels d’organes ou de tissu prenant en compte les variations anatomiques et les pathologies permettra la conception de prothèses morpho-adaptées et le développement d’ancillaires pour guider le geste chirurgical et positionner les implants. Les collaborations entre biomécaniciens et cliniciens devraient être de plus en plus importantes pour répondre rapidement à des questions cliniques, permettant la validation de certaines hypothèses des chirurgiens.
Avez-vous une anecdote particulière ?
Une anecdote qui illustre bien les aléas de l’organisation scientifique. Lors d’une réunion du GDR Biomécanique des chocs, à Strasbourg, un soir de décembre, nous avons découvert à 19h que les réservations d’hôtel pour la trentaine de participants que nous étions n’avaient pas été confirmées. En plein marché de Noël, trouver un hébergement relevait du défi ! Pourtant, à 20h, nous avons réussi à dénicher un hôtel, un peu excentré certes, mais capable de nous accueillir tous… et qui, cerise sur le gâteau, a accepté que nous n’y allions qu’après notre dîner, heureusement réservé, lui.
Un mot de conclusion ?
Me tourner vers la biomécanique a été pour moi une formidable occasion de sortir de ma zone de confort et de relever un défi passionnant. Cette réorientation m’a ouvert à de nouvelles disciplines et m’a convaincu de l’importance de la pluridisciplinarité, qui est devenue la pierre angulaire de l’équipe que j’ai construite au sein de l’Institut des Sciences du Mouvement.
Avec Jean-Noël Argenson et Pierre Champsaur, respectivement patrons marseillais de l’orthopédie et de la radiologie, nous avons su fédérer des collègues de différents laboratoires autour d’un projet commun. Malgré un soutien interne limité, mais avec l’appui du CNRS et de l’Université, notre équipe est devenue la plus importante de l’ISM, rassemblant plus de vingt chercheurs — médecins, biologistes, biomécaniciens et mécaniciens des matériaux. Cette diversité a permis une approche intégrée des problématiques étudiées.
L’installation de l’équipe au cœur même de l’hôpital, entre les blocs opératoires et le service d’imagerie, a marqué une étape symbolique et stratégique : elle a créé un véritable continuum entre clinique, recherche, industrie et formation. L’accueil de cliniciens et de scientifiques de diverses formations dans le master Bioingénierie des Implants et des Tissus a constitué un vivier précieux de doctorants.
En résumé, cette aventure m’a montré que les ponts entre disciplines, et surtout entre recherche et clinique, sont l’une des clés pour répondre efficacement aux enjeux scientifiques et médicaux de demain.
Propos recueillis par Y. Payan