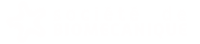Ce court article n’a nullement la prétention de retracer une histoire exhaustive et pleinement contextualisée des sciences du mouvement humain. Trop de contributions à cette aventure en auront été volontairement oubliées. Il s’inscrit plutôt dans la continuité d’articles antérieurs de cette série, avec l’intention de porter un bref regard sur les grandes étapes et les événements significatifs qui ont marqué ce développement et son élargissement progressif à toutes
les approches scientifiques que nous connaissons aujourd’hui.
De fait, fixer une date de début de développement des sciences du mouvement n’est déjà pas une gageure, selon la conception que l’on s’en fait. Surtout, il semble que cette petite histoire est largement dépendante du champ scientifique considéré, avec des décalages temporels significatifs : l’anatomie d’abord dès le 15ème siècle, puis la physiologie des grandes fonctions au 18ème, l’analyse du mouvement et les neurosciences à cheval sur les 19ème et 20ème siècles et plus récemment encore, à partir de la moitié du 20ème siècle, les sciences humaines et sociales, ouvrant la voie, aujourd’hui, à des approches de plus en plus interdisciplinaires et intégratives.
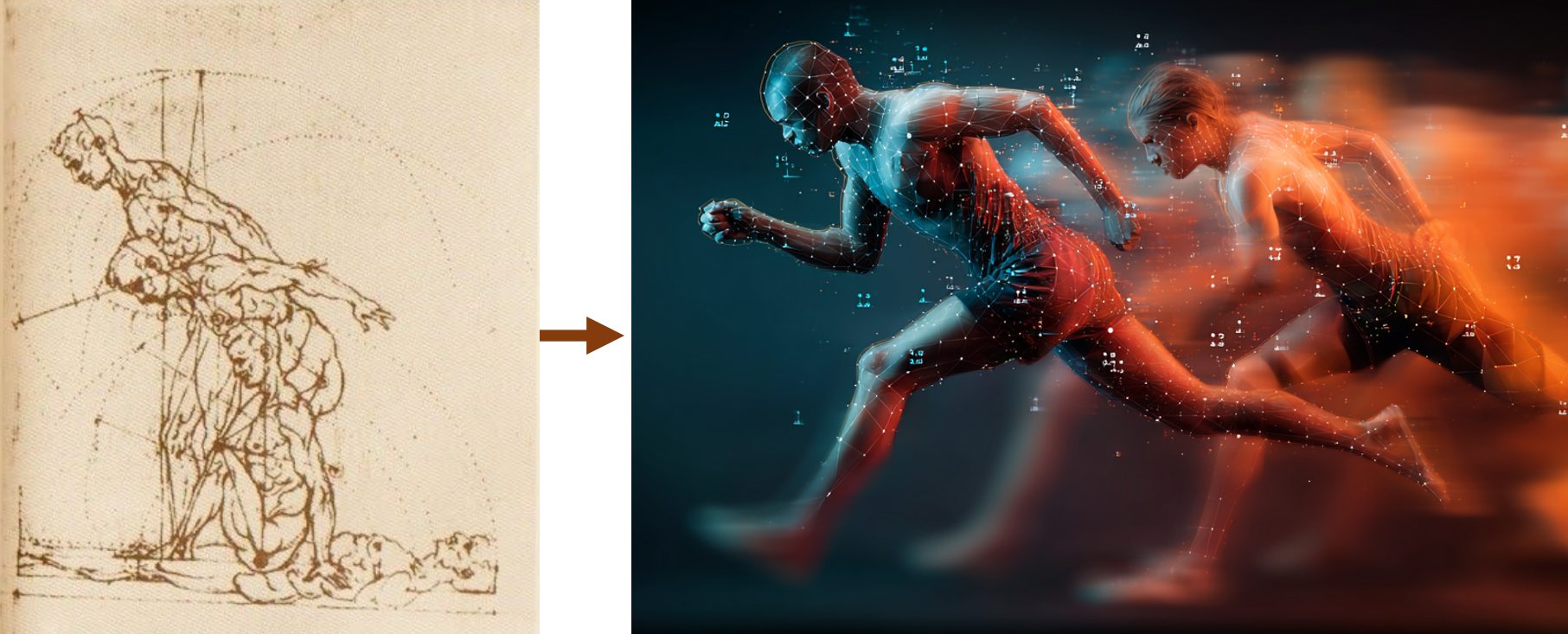
De Léonard de Vinci à l’IA*…
(Crédits : Image Léonard de Vinci : étude du corps en mouvement, codex Huygens, folio 22 - https://fr.pinterest.com/pin/616359898981977939/ ; Image IA : https://alphaavenue.ai/fr/magazin-fr/technologie/presentation-dact-two-la-capture-de-mouvement-nouvelle-generation-par-runway/ reproduite avec autorisation de l’auteur, Justus Becker)
Anatomie : de l’organe à la fonction
Peut-être que les travaux de Léonard de Vinci dans la deuxième moitié du 15ème siècle, en développant une approche anatomique « moderne » et dynamique, à la base du mouvement humain, constituent un premier jalon précoce mais significatif. Ce petit extrait des carnets de Léonard de Vinci illustre bien une vision qui va déjà au-delà d’une simple description du corps humain :
« …tu représenteras le bon fonctionnement de ces membres : c’est-à-dire dans l’acte de se lever après s’être couché, remuant, courant et sautant en des attitudes variées, soulevant et portant de gros poids, lançant des objets au loin et nageant ; et ainsi pour chaque mouvement tu démontreras quels membres et quels muscles le déterminent, et notamment le jeu des bras » (Maccurdy E, p. 106) [1]
Plus précisément, Léonard de Vinci est le premier à associer l’action musculaire aux contraintes subies par les os. Il fait de la fonction neuro-musculaire une réalité objective en créant des maquettes du squelette dans lesquelles des cordelettes remplacent les muscles, mettant en évidence les notions de mécanique, de synergies fonctionnelles ou encore d’équilibre entre muscles antagonistes, tout comme il évoque, en particulier pour la main, le rôle de poulies de renvoie des tendons fléchisseurs des doigts, préfigurant la notion de couple en biomécanique. Nous sommes déjà dans une approche de l’anatomie fonctionnelle et dans l’usage de terminologies qui sont encore couramment employées dans la biomécanique moderne.
Dans cette veine, les écorchés de Honoré Fragonard (1732-1799), qui font la célébrité du musée portant son nom à Maison-Alfort, constituent une étape
importante dans la description anatomique du corps humain « en action », y compris dans des « situations sportives » de cavaliers à cheval. De manière implicite, car Fragonard n’a laissé aucun écrit tangible à ce sujet, ces écorchés suggèrent que comprendre le corps implique comprendre le mouvement qui l’anime.
La découverte des grandes fonctions de l’organisme
Dès la fin du 18ème siècle, les travaux d’Antoine Lavoisier puis plus tard ceux de Marcellin Berthelot ont signé les débuts de la quantification de l’énergie
métabolique dépensée par un sujet produisant un travail mécanique. C’est Lavoisier qui est à l’origine de la stœchiométrie, méthode de calcul permettant d’analyser la quantité de réactifs et de produits en jeu dans une réaction chimique. Il a en particulier traduit des réactions dans les équations chimiques respectant la loi fondamentale de conservation de la matière, la loi bien connue de Lavoisier selon laquelle rien ne se perd ni ne se crée et tout se transforme :
« … car rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération ; que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. » [2].
De son côté, Berthelot a émis le principe "du travail maximal", ou principe de Berthelot, selon lequel un système laissé à lui-même évolue dans le sens qui mène au plus grand dégagement de chaleur. En d’autres termes, toute réaction chimique s'accomplissant sans apport d'énergie évolue vers le système de corps qui dégage le plus de chaleur. On mesure évidemment les conséquences de ce principe dans les relations entre dépense énergétique et température corporelle lors d’un effort musculaire.
À la même période, l’anatomiste et médecin italien Luigi Gavalni découvrit, par hasard, la contraction réflexe sur des cuisses de grenouille qu’il avait disséquées. Cette découverte d’une électricité animale [3] à l’origine du mouvement se propageant au sein de divers tissus biologiques donnera naissance à l’électrophysiologie dont nous connaissons les déclinaisons actuelles avec l’électromyographie (EMG), l’électroencéphalographie (EEG) ou encore l’électrocardiologie (ECG).
Ainsi, en 1843, l’allemand Emil du Bois-Reymond met au point, pour ses études sur l’électricité animale (en particulier les poissons électriques), un galvanomètre particulièrement sensible qui va démontrer la possibilité d’enregistrer l’activité électrique d’un muscle lors d’une contraction volontaire. Il ouvrira la voie au premier enregistrement en 1890 par Jules-Etienne Marey : l’électromyographie était née ! De son côté, le méconnu néerlandais Willem Einthoven, pourtant prix Nobel de médecine en 1924 pour l’ensemble de son œuvre, inventa dès 1901 le premier galvanomètre à corde, énorme machine de 270 kilos, nécessitant un système de refroidissement et cinq personnes pour la faire fonctionner. Les premiers essais cliniques avec cette machine s’affranchissant des calculs fastidieux imposés par l’électromètre capillaire remontent à 1902. C'est l'un des tout premiers appareils permettant aux médecins d'enregistrer avec précision à partir de la surface du corps les potentiels électriques générés par le cœur humain au cours de ses battements. L’électrocardiographie venait de
prendre son envol et conduisait même, en 1906 et pour la première fois, à des échanges d’ECG cliniques télétransmis en utilisant une connexion par câble entre l'hôpital universitaire de Leyde et le laboratoire de Willem Einthoven. Ce précurseur donnera son nom au « triangle d’Einthoven » : un triangle équilatéral formé par des électrodes positionnées sur les deux membres supérieurs (poignets) et le membre inférieur gauche (jambe), au centre duquel se situe approximativement le cœur [4]. Ce triangle est toujours le standard pour étudier l’activité électrique du cœur sous des angles différents et calculer son axe électrique dans le plan frontal.
Quand l’étude du mouvement devient scientifique
E.J. Marey est sans aucun doute celui qui aura marqué un tournant dans l’histoire des sciences du mouvement en posant dès 1870 les bases de l’analyse du mouvement et de la biomécanique (pour un portrait plus complet, cf. l’article de Simon Bouisset dédié à E.J. Marey sur le site de la Société Française de
Biomécanique - https://www.biomecanique.org/fr/les-pionniers-sdb/437-marey). L’invention en 1882 du fusil photographique permettant de capturer le
mouvement sur une même plaque en douze poses successives ouvre l’ère de la chronophotographie qui constitue un tournant pour l’étude de la cinématique
des mouvements du corps tout comme des forces qui créent ce mouvement. Il est intéressant de noter comment le développement des techniques photographiques et cinématographiques a pu donner toute son importance à l’animation, au mouvement d’abord de la locomotion animale puis de la locomotion humaine et de ses dérivés.
Au cours de la même période, E.-J. Marey invente également la première plateforme de force de l’histoire de la biomécanique : la « table dynamométrique » encore appelée « platefor me dynamographique » ou « dynamographe » [5]. Cet appareil permettait déjà d’enregistrer les actions exercées au sol par un sujet au repos ou en mouvement. Ce que l’on sait moins, c’est que dès 1859, en collaboration avec le physiologiste et vétérinaire Auguste Chauveau et le fabricant de montres Bréguet, E.J. Marey a développé, à partir d’une idée originale du physiologiste allemand Karl von Vierordt, un sphygmographe portable permettant de mesurer les pulsations cardiaques.
Il faut néanmoins associer à ces développements et découvertes le principal collaborateur de Marey, George Demenÿ, souvent occulté car ces deux pionniers furent vite en désaccord. Marey s’intéressait principalement aux approches expérimentales du mouvement quand Demenÿ réfléchissait davantage aux mises en application possibles, préfigurant ainsi le développement de l’éducation physique scientifique, de la pédagogie pour l’enseigner, et finalement des sciences de l’éducation appliquées au mouvement humain.
Durant la même période, Charles Scott Sherrington (1857-1952) mit en lumière le principe de l’innervation réciproque (la loi de Sherrington), selon laquelle à la
stimulation d'un groupe de muscles correspond l'inhibition des muscles du groupe opposé. Dans son ouvrage Integrative Action of the Nervous System (1906), il fournit la première analyse moderne du cervelet, décrit les réflexes proprioceptifs, inventa le terme de synapse et étudia les modalités de la transmission synaptique de l'influx nerveux. Plus largement, il développa la notion de structuration fonctionnelle des centres nerveux, conduisant elle-même au concept d’intégration nerveuse qui nous est si familier aujourd’hui. En France, depuis les années 1950, les travaux de Jacques Paillard, Marc
Jeannerod, Jean Massion, et plus récemment Alain Berthoz, et leur intérêt toujours affirmé pour les sciences du mouvement humain, ont fortement influencé les générations de chercheurs d’aujourd’hui.
Dans ce contexte, le développement de la chronométrie mentale permettra d’ouvrir une nouvelle page d’exploration du système nerveux pour explorer
indirectement les « fondements » sensori-moteurs du mouvement humain. Si les premiers travaux remontent à la fin du 19ème siècle, la chronométrie mentale connaitra son apogée dans la seconde moitié du 20ème avec des milliers de publications explorant à la fois les aspects sensoriels et/ou moteur du comportement humain. La psychologie cognitive, explorant les diverses modalités de traitement de l’information, prendra désormais une place déterminante. Plus récemment, ces 20 dernières années, de nouvelles techniques, nettement plus sophistiquées -électroencéphalographie, IRM fonctionnelle, NIRS,
Stimulation Magnétique Transcrânienne -, permettront des investigations plus directes pour accéder au fonctionnement du cerveau, supportant le développement sans précédent des neurosciences modernes.
En parallèle, le développement de l’accélérométrie préfigure le temps de la mesure embarquée. Pourtant, on doit les premiers travaux sur l’accélération au
Mathématicien George Atwood (1746-1807), professeur de physique à Cambridge en Angleterre. C’est en travaillant sur la valeur de l’accélération de la pesanteur et l’étude de la chute libre qu’il mit au point en 1784 sa célèbre « machine d’Atwood ». Aujourd’hui, il existe de nombreux types d'accéléromètres, répondant à des besoins très différents dans les domaines industriel, militaire ou sportif : au fil des années, la technologie a évolué pour aboutir au développement d'accéléromètres piézoélectriques et d'accéléromètres MEMS (microelectromechanical systems). Ce sont ces accéléromètres, les plus répandus aujourd'hui, que l’on retrouve généralement associés à des gyroscopes et magnétomètres au sein des centrales inertielles 3D modernes (IMUs).
Le comportement dans son environnement
À la fin des années 50, les sciences humaines et sociales vont également prendre leur essor. En particulier, la psychologie, la sociologie et les sciences de l’éducation permettront de situer le comportement de l’homme en mouvement dans son environnement pris au sens large. Ces approches vont mettre en avant l’usage de méthodes issues de l’ethnologie, des grilles d’observation, des enquêtes à vaste échelle et questionnaires ouverts ou fermés, ou encore des entretiens en face à face. Le sujet sportif n’est plus simplement une machine anatomique ou physiologique, un corps en mouvement. Il devient un individu dont les choix de pratique, les émotions, les motivations ou encore les attitudes à l’égard du sport sont auscultés et analysés à l’aune d’un contexte économique, social, familial, personnel, ou encore géographique voire historique.
Les travaux, entre autres, de Sigmund Freud, Jean Piaget, Henri Piéron ou Henri Wallon ont inspiré ce qui deviendra la psychologie du sport au début des années 60, en particulier sous l’impulsion de l’Italien Ferrucio Antonelli. Ces travaux ont aussi contribué au développement de la pédagogie et des sciences de
l’éducation avec les précurseurs français qu’ont été Gaston Mialaret, Jean Château ou encore Maurice Debesse, à la fin des années 50. Dans le domaine de la
sociologie, ceux de Pierre Bourdieu et Jean-Paul Passeron et de leurs condisciples, ou encore de Joffre Dumazedier et sa sociologie des loisirs ont donné naissance à divers courants de pensée sociologique autour du sport dont Pierre Parlebas ou Christian Pociello furent parmi les précurseurs en France. Mais c’est sans compter les multiples écrits de George Vigarello autour de l’histoire et de la philosophie du sport et du corps, qui ont donné une impulsion définitive à des regards nouveaux portés sur le mouvement, au-delà des approches « mécanistiques » ou « fonctionnelles » du mouvement humain. Le corps comme entité « sociale » devient objet d’étude à part entière.
Dès lors, depuis les années 1970-1980, au moment où la 74ème section du CNU (STAPS) est créée en 1983, l’ensemble des disciplines scientifiques, sans exclusive, apporteront leur contribution à l’étude du sport et de la motricité humaine, à la fois de manière spécifique et focalisée, mais aussi dans des perspectives de plus en plus multi- ou interdisciplinaires. La « mesure » et la réflexion qui en découlent deviennent multifactorielles.
L’intelligence artificielle et le temps de la mesure embarquée
Ces 20 dernières années ont ouvert une nouvelle ère reposant sur le développement massif des approches algorithmiques et l’avènement de l’intelligence
artificielle, d’une part, la miniaturisation de l’électronique et des équipements, d’autre part. Ces développements ont conduit à l’usage de plus en plus
fréquent et souvent combiné 1) des mesures in situ et embarquées et 2) des approches multidimensionnelles du mouvement.
Les mesures embarquées
Aujourd’hui, les mesures embarquées sont en passe de devenir la panacée. La miniaturisation des composants électroniques, le développement des réseaux « sans fil » et l’augmentation des flux possibles de transmission de données, l’augmentation de la puissance et de la durée de vie des batteries portables permettent de mesurer le mouvement au plus près de la réalité, en situations dites « écologiques », sans pour autant remettre en cause les fondements de l’approche expérimentale de laboratoire. De plus en plus souvent et « facilement », on peut aller « sur le terrain » et mesurer en « vrai » les comportements ou performances, sans remettre en cause la rigueur méthodologique nécessaire. Dans le domaine des pratiques sportives, cela s’avère un argument décisif
pour convaincre des athlètes ou entraîneurs à se soumettre à des protocoles expérimentaux souvent fastidieux à leurs yeux et n’ayant pour eux pas ou peu de
sens, dès lors que cela se déroule en laboratoire et trop loin du terrain.
Les approches multidimensionnelles de la motricité humaine
L’algorithmie embarquée, les méthodes de plus en plus sophistiquées de traitement du signal, les techniques statistiques d’analyse multidimensionnelle du mouvement en clustering, basées sur de multiples modèles d’apprentissage machine supervisé ou non supervisé deviennent les outils quotidiens du chercheur moderne. S’ajoute à ces outils, la prise de conscience progressive, devenue aujourd’hui évidence, que la performance motrice résulte de systèmes complexes [6] et du croisement de multiples facteurs, conduisant de plus en plus souvent les chercheurs à favoriser des approches combinées, où les différentes connaissances scientifiques s’interpellent et surtout se complètent et s’enrichissent mutuellement, même si ce dialogue reste souvent difficile.
Et demain ?
Il est évidemment difficile de se projeter dans l’avenir, mais on peut au moins anticiper ou dessiner quelques tendances et évolutions futures probables ou possibles. La révolution numérique, dans toutes ses dimensions, aura sans aucun doute un impact majeur sur les travaux à venir. Les travaux aux interfaces ne manqueront pas non plus de prendre peu à peu toute la place qu’ils méritent.
L’ouverture à des disciplines scientifiques en apparence éloignées permettra sans doute l’utilisation de nouveaux instruments d’investigation et d’offrir de
nouvelles perspectives de compréhension du mouvement humain (physique, mathématiques, informatique, robotique, imagerie, etc.). La question des approches micro ou macro et de leur complémentarité se posera sans doute de manière plus cruciale, obligeant à un dialogue entre disciplines encore plus indispensable. Les exemples de la physiologie de l’exercice ou des neurosciences sont de ce point de vue éclairants. La physiologie intégrative a progressivement été dévalorisée voire mise de côté, laissant place à la physiologie cellulaire puis moléculaire. Mais le fonctionnement d’une molécule,
d’une cellule ou d’un ensemble de cellules ne peut à lui seul expliquer un comportement moteur complexe. De même, les neurosciences comportementales sont devenues cognitives, fonctionnelles, computationnelles, cellulaires, moléculaires, etc., constituant autant de domaines et de communautés scientifiques compartimentés par leurs objets et leurs techniques d’étude spécifiques. Pourtant, la compréhension des problèmes posés réside sans aucun doute dans des interactions multiples et complexes qui restent encore largement à décrypter en s’appuyant sur des modèles, approches, méthodologies et outils encore à inventer.
Bibliographie
[1] Maccurdy E. (Trad.). (2000). Leonard de Vinci. Les carnets. Gallimard.
[2] Lavoisier A. (1789). Traité élémentaire de chimie, p. 140/141.
[3] Bernardi W. (2001). La controverse sur l'électricité animale dans l'Italie du XVIIIe siècle : Galvani, Volta et... d'autres /The controversy over animal electricity in 18th-century Italy : Galvani, Volta and... others. Revue d'histoire des sciences, 54-1 pp. 53-70.
[4] Fye WB. (1994). A history of the origin, evolution, and impact of electrocardiography. Am J Cardiol; 73:937-49.
[5] Marey E.J. (1883). De la mesure dans les différents actes de la locomotion. C.R. Acad. Sci., Paris, 97, 820-825.
[6] Davids K., Hristovski R., Araújo D., Balague Serre N., Button C., Passos P. (2015). Complex Systems in Sport, Routledge.
Vincent Nougier, novembre 2025
Professeur émérite, Université de Grenoble Alpes